Pétrole ! Upton Sinclair, 1927
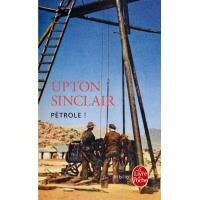 Upton Sinclair est un de mes excellents amis depuis que j’ai lu sa Jungle, une œuvre vraiment admirable, à la fois pathétique et féroce, une littérature sensible et de combat. Si elle ne tirait un peu excessivement sur la corde de la pitié, sans doute serait-elle quelque chose de tout à fait parfait à mon goût. Et certes, un homme qui se moque à ce point de plaire à ses contemporains est certainement un être esseulé et socialement condamné qui ne trouvera pas d’inconvénient à quelque soutien rare pour affronter la solitude et renoncer au pistolet sur la tempe. Aussi lui prêté-je volontiers ma main droite à serrer et mon dos sur quoi s’appuyer…
Upton Sinclair est un de mes excellents amis depuis que j’ai lu sa Jungle, une œuvre vraiment admirable, à la fois pathétique et féroce, une littérature sensible et de combat. Si elle ne tirait un peu excessivement sur la corde de la pitié, sans doute serait-elle quelque chose de tout à fait parfait à mon goût. Et certes, un homme qui se moque à ce point de plaire à ses contemporains est certainement un être esseulé et socialement condamné qui ne trouvera pas d’inconvénient à quelque soutien rare pour affronter la solitude et renoncer au pistolet sur la tempe. Aussi lui prêté-je volontiers ma main droite à serrer et mon dos sur quoi s’appuyer…
Quoi ? Il est mort peut-être et n’en a plus besoin ? Eh bien, c’est alors que moi j’en ai besoin plus que lui !
Il existe dans le genre réaliste toutes sortes de courants, une variété de conceptions quasiment opposées et qui n’ont pas encore été nettement identifiées, à ma connaissance. La distinction de ces variétés ne tient pas seulement compte de la forme qui est toujours une source de réductions inutiles et absurdes, mais bien de l’intention de l’écrivain et de l’effet auquel il aspire avant même l’écriture de son premier mot.
S’il fallait que je proposasse les linéaments d’une telle classification, je dirais que Zola, par exemple, était nettement un réaliste à thèses, c’est-à-dire un réaliste d’université, une sorte de littérateur doctorant : il voyait des idées partout, des concepts soi-disant universels pour valoriser sa carrière en ayant l’air d’être à l’origine de trouvailles… de sorte que peut-être, en fin de compte, il ne voyait de réalités nulle part mais bien davantage des représentations. On peut raisonnablement douter qu’il observait des objets et des gens en dehors des désirs qu’il y projetait et des conclusions qu’il en avait déjà formées quand il réunissait ses « carnets » sur le terrain. Je n’ai jamais vu dans ses romans que des faits déjà longuement connus, vaguement tendancieux, et des extrapolations à la mode. Une ouvrière devait être pour lui une sorte d’entité utile, et une machine industrielle un prétexte à une description enlevée sur le modèle de « Mélancholia » de Hugo ; il posait certainement à tout ce petit monde des questions et des regards bien singuliers et orientés ! Quoiqu’on dise, je crois que ce sont des figures comme Zola qui ont inventé la religion, la phrénologie et l’idéologie raciale, n’en déplaise aux partisans du célèbre « J’accuse ».
Sur une ligne nettement parallèle et distincte, on trouverait le réalisme sentimental, par lequel un auteur souhaite divertir et émouvoir au moyen des péripéties amoureuses d’un personnage en général féminin ; alors, pour donner à son intrigue une note d’implication plus efficace, il le situe au sein d’un univers contemporain et vraisemblable. Un tel auteur – par exemple Jane Austen, Thomas Hardy, Gustave Faubert, Guy de Maupassant, Anthony Trollope et jusqu’à Somerset Maugham –, ne souhaite pas fondamentalement rendre une théorie sociale, exposer un principe ou édifier sur une situation concrète de quelque manière que ce soit : cela peut arriver, mais ce n’est pas l’esprit avec lequel l’œuvre est véritablement entreprise. C’est plutôt l’épanchement et le partage de passions transposables qui sont visés dès l’origine, et cette intention est logiquement vite perceptible et donne lieu, quelquefois ou souvent, à des débordements déraisonnables où le protagoniste apparaît dénué de rationalité, de recul et de bon sens : c’est le prix à payer – je veux parler d’un certain excès émotionnel – pour susciter rapidement l’empathie du lecteur.
À côté d’eux, sur une autre ligne d’effets bien séparée, je distinguerais le réalisme esthétique, plus rare et typique par exemple de la littérature dite « fin-de-siècle », où le cadre apparemment concret ne sert qu’à valoriser un style, notamment précieux ou byzantin, comme c’est le cas chez Joris-Karl Huysmans, Catulle Mendès, Jules Renard ou peut-être Albert Cohen. On n’a pas même alors l’impression de suivre une intrigue, cette préoccupation-là fut tout extérieure au projet d’origine : il s'est plutôt agi de démontrer qu’en partant d’une matière connue et parfois même rebattue, l’auteur était capable d’une virtuosité nouvelle et d’un ton hors de mode ; et cet effort a produit des originalités qui n’ont à peu près d’intérêt que stylistique – encore que ce ne soit pas du tout un intérêt maigre ou facile.
Inutile de me parler de ce « réalisme » actuel, qui n’est, pour l’essentiel, qu’un pseudoréalisme contemporain. Si c’est pour prétendre par exemple que Houellebecq est un réaliste au prétexte qu’il parle de sexe et d’ordinateur au bureau (les deux au bureau), ou bien que Nothomb ou je ne sais quelle dame en est aussi parce qu’elle dit je ne sais quoi sur la vie fantasmée ou améliorée des femmes d’aujourd’hui (avec ou sans menotte), alors je préfère m’en aller tout de suite et quitter la conversation. Je n’accorde déjà pas facilement à ces récits l’appellation de littérature, alors quant à évoquer à leur attribuer l’idée de réalisme ! La vérité, c’est que ces textes ne disent à peu près rien de la société où ils naissent si ce n’est son état de laisser-aller et de superficialité mentales : le lectorat n’y trouve qu’un divertissement narcissique et indigne même à être nommé « intrigue », et le monde de l’édition s’y devine par son inlassable, piètre et pathétique recherche d’une littérature thématique représentative d’une époque et par sa criante absence de faculté à discerner au-delà des objets du monde ce qui fait l’essence d’une réalité. On y devine tout au mieux, mais au second degré loin derrière la conscience de ses amateurs, un vague désir d’assumer agréablement une insatisfaction reconnue et bien identifiable, une plaisante grogne des vexations du moment – ce en quoi se distingue ce qu’on ne pourrait appeler tout à fait un courant : une tentative, une ébauche, rien qu’un râle mêlé de soulagement instantané et suffisant à étancher sa cause.
Mais tout autre est ce réalisme qui consiste, avec aussi peu de pensées préconçues que possible, à relater des faits indubitables mais recelés, recelés parce que plus ou moins inconfortables voire tout à fait importuns pour un vaste milieu ou même une Nation – et parfois avec une pointe de satire chargée de donner du piquant à la narration : je l’appelle le réalisme critique. Lire en ce sens Sherwood Anderson, Theodore Dreiser, Richard Wright, Sinclair Lewis, Upton Sinclair, John Steinbeck, Truman Capote, Edward Abbey... qui furent les poils à gratter et les empêcheurs de tourner en rond de la morale américaine. On découvrira alors qu’en France, par comparaison, on a tout juste exposé des théories compliquées, pseudo-scientifiques et pas trop inacceptables pour être mises en scène où par exemple la progéniture d’un ouvrier fut longtemps un monstre difforme, analphabète et promis à la dégénérescence sexuelle et alcoolique – on soutint cela, on le prouva, c’était pourtant tout à fait une élaboration de Troisième Reich – tandis qu’aux Etats-Unis, cette caricature donnait déjà la nausée du temps de la guerre de Sécession. En France, quand les éditeurs réclamaient à leurs artistes de ne pas heurter la sensibilité des minorités parmi lesquelles certains de leurs lecteurs devaient nécessairement se trouver et particulièrement la minorité des investisseurs, au même moment l’industrie alimentaire portait plainte contre le brave Sinclair pour diffamation, et… à la fin, dans une société pourtant fervente du succès économique et de la gloire patriotique, c’est Sinclair qui l’emporta !
Dans Pétrole ! l’auteur ose encore dénoncer un rêve américain en l’espèce de l’exploitation des gisements du fameux « or noir » – activité fort symbolique et lucrative en 1927 où le livre fut écrit. Il excelle à décrire, dans une prose subtile et efficace, aussi bien l’intérêt passionné de J. Arnold Ross dont la vie est un éternel investissement en derricks, pipelines et raffineries, que les émerveillements et inquiétudes de son fils Bunnny appelé à assurer sa succession mais dont l’âme honnête est au rejet des corruptions et à la découverte du socialisme, sans oublier les méticuleuses explications sur les moyens techniques et humains liés à l’extraction du pétrole, forage, cimentage, cuvelage, raffinage… C’est en tout un travail formidable, impressionnant tant d’humanité fine que de documentation rigoureuse où se mêle la révélation d’une perpétuelle lutte pour l’argent atteignant même tous les milieux : petits propriétaires fonciers, salariés du pétrole, exploitants cupides, prêtres détraqués, bourgeois déconnectés, politiciens corrompus. Ce livre révèle les mouvements d’une danse extrêmement cynique et folle, une euphorie acharnée de la fortune et du profit où le succès financier apparaît comme résultante d’une suite inexorable de compromissions et de vices qu’un fils effaré constate sans pouvoir agir : c’est là toute la marche du monde, argue toujours le père.
Extrêmement touchante aussi cette affection mutuelle et filiale qui lie la plupart des péripéties comme autant de souvenirs d’enfance et de traces lumineuses laissées sur la pellicule de la mémoire : les promenades sensationnelles en automobile, l’aura presque sacrée du père ingénieux et adoré, les parties de camping entre hommes, les emballements du cœur à l’abord de nouveaux gisements ; un récit d’initiation, en somme, où un fils admirant et découvrant son père en vient à s’interroger peu à peu sur la légitimité de cet effort traditionnelle et insatiable du gain.
Ce roman colossal de presque un millier de pages débute d’une façon magistrale comme une révélation d’univers – et c’est vraiment le mieux que puisse faire un auteur réaliste de nous présenter un microcosme inconnu, insoupçonné même, à la façon d’une explicitation éblouissante : on comprend, sans impression de grossissement, les roublardises et les négociations d’achat, les détours légaux, les dispositifs techniques, les risques et les accidents d’exploitation ainsi que leurs exactes solutions, l’organisation influente des syndicats pétroliers et leurs modes de gestion des grèves de travailleurs, la concussion systématique mouillant, baignant, inondant de noirceur aqueuse tout ce qui trempe dans cette entreprise féroce et amorale du pétrole…Le premier tiers du livre est une étourdissante merveille, dense et colorée, relatant toutes les étapes méthodiques et excitantes de la découverte d’un gisement à son exploitation au nom de Ross Jr. ; on en retient même, sentiment galvanisant, l’impression d’une large bouffée d’Amérique, avec ses climats, ses décors, ses rites, ses mœurs et son exaltation typique de liberté un peu extravagante, en somme tout ce qui fait, depuis que les États-Unis se cherchent des écrivains, la fierté d’une véritable identité littéraire nationale. C’est beau et profond comme une voile peinte exposée en pleine lumière, on y sent l’immense affection d’un homme pour sa terre, pour les hommes qui y vivent et pour la diversité bienheureuse de leurs modes de vie. Une curiosité intense, épanouie dirige le regard de Sinclair dans toutes les directions, goûtant chaque chose, relatant le soleil, les accents et la vie, et on y perçoit toute une réjouissance généreuse d’en partager les saveurs et de retranscrire les émotions intimes de l’existence au sein d’un univers composite de satisfactions et d’opportunités.
Tout cela confine au chef d’œuvre, vraiment, comme dans certaines des plus pittoresques pages contemplatives de London ou Steinbeck. C’est vif et c’est profond ; on respire un ambitieux vent de pleine littérature ; on se sent porté par des airs supérieurement purs où l’humanité et l’art se mêlent en voltigeant avec une incomparable fluidité.
Mais l’au-delà de ce premier tiers du livre est, de mon point de vue, un peu moins bon.
Et c’est pourtant presque insensible, on glisse imperceptiblement aux environs de la partie VII vers autre chose, et plus le temps passe, plus le récit se développe et s’élargit, plus on s’interroge sur une impression vague d’étrangeté et de superflu, sans comprendre exactement d’abord quelle est la source de l’écart : le style est bien le même, l’intrigue poursuit logiquement la formation universitaire de Bunny qu’on découvre de plus en plus édifié par des idéologies de gauche… En toile de fond, l’histoire mondiale se poursuit avec les développements de la Grande Guerre, où le pétrole occupe tout vraisemblablement une place d’importance – et ces années franchies n’abîment même en rien l’unité de temps…
Oui mais : où est passé notre précieux puits initial dans ce si pittoresque pays de sensations et d’idées ? Et pourquoi s’éloigne-t-on de ce grisant sentiment d’appartenance où le réalisme servait à tracer le portrait d’un gisement en particulier et de ses premiers derricks ?
Parti, envolé, confisqué, le champ glorieux des doux commencements. L’engrenage est tourné, il faut murir, voir Bunny devenir homme et se confronter à la tout puissante logique universelle et sociale : le monde n’est pas contenu dans un seul puits, que diable ! Certes, mais ce recul éloigne du sujet qu’on croyait circonscrit d’abord : les premières amours de Ross Jr n’étaient pas apparemment prévues au programme ou bien j’avais mal compris, et ni le contenu de ses études, ni les délires d’un escroc à la religion ne figuraient dans les attentes logiques… Le récit prend un tournant inattendu, moins intime et affectueux, et peu à peu il se métamorphose en une dénonciation des persécutions contre les communistes ; ce thème prend même progressivement toute la place, et j’ignore si c’est la suite nécessaire de cette ruée vers l’or noir mais ça paraît tout à fait autre chose que la description d’un milieu : c’est devenu la critique du système capitaliste dans son ensemble et de ses brutalités obligées, et le pétrole même acquiert une dimension secondaire, théorique et lointaine.
La relation des amours de Bunny, par exemple, ne sert alors qu’à illustrer comment son argent attire en-dehors de sa personne, comment sa classe vit déconnectée des préoccupations ordinaires, comment son caractère éprouve l’attirance paradoxale des théories socialistes et bolchéviques ; ses actions et ses dires, sans plus rien dévoiler de la colossale machine pétrolière, indiquent des contradictions insolubles, tant de dilemmes moraux insurmontés où le type même du personnage ressort affaibli, affadi, éternellement indécis : en cela ce n’est pas du tout un récit de formation, mais le roman d’un renoncement passif aux valeurs de l’argent. Bunny n’est qu’un perpétuel observateur, certes pratique pour l’auteur à nous rendre témoins extérieurs comme lui, une utilité en somme ; mais est-il vraiment possible, à ce point ? La dimension psychologique paraît assez négligée, c’est toujours le même fils à papa, et l’auteur peine à y injecter une sentimentalité crédible et profonde : Sinclair ne me semble pas fort compétent à cet exercice, après tout ; c’était déjà probablement l’inconvénient avec La Jungle, on y trouvait des marionnettes, on n’était jamais surpris par des introspections complexes c’est-à-dire vraiment humaines.
Le défaut de cet ouvrage, c’est peut-être, en somme, de n’avoir pas tout à fait admis qu’on ne peut pas placer tous les souffles dans un même bocal, toutes les représentations dans un seul livre : il eût fallu métaphoriser quelque peu au lieu d’élire systématiquement toutes les situations où introduire un protagoniste dans une posture éloquente ; il y a par trop dilution de l’idée fondatrice, et l’unité non de temps comme j’écrivais mais d’intrigue se répand et se perd. Le récit reste pourtant majestueux, son style ne souffre d’aucun vice, mais il est à la fois trop démonstratif et imparfaitement tenu, comme ces jus excessivement mélangés, fort goûteux par eux-mêmes mais dont on ne distingue plus les fruits d’origine : la saveur en devient bizarre et incongrue, et on oublie l’idée même de finesse dans la superposition pléthorique de ce qu’il faut absolument chercher et qui nous détourne de l’efficacité des ingrédients primordiaux.
N’importe, c’est un beau roman, minutieux, audacieux, incontestablement risqué : il y aurait assurément du tort à condamner tout un livre pour un petit excédent d’ambition auquel une certaine forme ne saurait correspondre ; on ne retire pas son amitié pour si peu, en particulier quand l’émotion, si maîtrisée au début, ne fait que retomber légèrement sous l’effet de l’analyse et d’exigences quelque peu intellectuelles d’unité et d’effets. Je pousse trop loin peut-être ma recherche de perfection – ou ma volonté d’objectivité –, mais c’est pour rester juste et digne, et ne pas feindre d’ignorer, avec tant de complaisance ordinaire, que fort rares sont les amis parfaits, qu’imparfaits sont toujours nos amis même les plus chers, bien qu’une âme élevée en recherche toujours de meilleurs.
P.-S. : Je sais bien que la quatrième de couverture indique que There Will Be Blood, le film de Paul Thomas Anderson, est une adaptation de ce roman, mais je veux préciser que, dans cette adaptation, c’est à peine si on y retrouve la moindre substance du livre. J’ai regardé ce film peu après sa sortie en 2008, et je viens de relire son synopsis : le lecteur serait bien déçu s’il croyait qu’il s’y trouve plus que de vagues correspondances avec l’œuvre de Sinclair. Ce fut sans doute, de la part du réalisateur, un prétexte à succès que de prétendre à l’extraction d’un récit aussi célèbre, et c’est, de la part de l’éditeur, un assez scabreux opportunisme que de préciser un tel rapprochement, le film ayant bien marché. Quant à cette œuvre cinématographique, je n’en ai qu’un souvenir, après l’avoir acquise en DVD et revendue peu après : c’est qu’il s’agit d’une réalisation magnifiquement photographiée et jouée, mais aussi une de celles qu’on ne se sent de revoir qu’une fois tous les quinze ans, pour des raisons obscures qui tiennent à la faiblesse de la patience humaine et peut-être, aussi, à quelque petite autre chose impatientante inhérente au film lui-même.
***
« Pendant ce temps, les ouvriers travaillaient avec fureur pour arrêter l’écoulement. Ils couraient çà et là en titubant, à demi aveuglés par ce brouillard noir. Aucun endroit où ils pussent reprendre haleine ; rien où pouvoir s’accrocher : tout était gras, la graisse ruisselait sur tout. Vous vous agitiez dans les ténèbres, tâtonnant autour de vous sans autre guide pour déterminer la place du monstre, que son rugissement, ses coups sur votre corps, son crachement sur votre visage. On travaillait en haute tension, car des primes avaient été offertes : cinquante dollars par homme si l’écoulement était arrêté avant minuit, cent dollars s’il l’était avant dix heures. Nul ne pouvait se représenter combien de richesse ce monstre gâchait, mais cela devait être des milliers de dollars toutes les minutes. M. Culver y alla lui-même à corps perdu pour aider, et, dans ses téméraires efforts, il eut les deux tympans crevés. « Essayer d’arrêter le jaillissement avec sa tête ! » commenta sans sympathie un ouvrier. En outre, le propriétaire découvrit au cours des semaines suivantes qu’il avait accumulé un total de quarante-deux procès pour dégâts envers immeubles, vêtements, poulets, chèvres, vaches, choux, betteraves et automobiles qui avaient glissé dans les fossés sur les routes trop bien graissées. » (page 55)




/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/image%2F0404497%2F20240411%2Fob_9e1489_un-tramway-nomme-desir.jpeg)