Evasion, Benjamin Whitmer, 2018
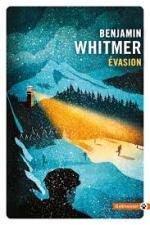 Si, comme je le pense, la philologie est une science, elle permet de distinguer ce que les amateurs ne peuvent voir, ainsi que de deviner ce qu’ils ne peuvent augurer. Conformément à ce que j’ai écrit par ailleurs, c’est l’apanage d’un professionnel de savoir et de prévoir. Aussi, pour ne pas indûment se vanter, il lui faut régulièrement faire la preuve de sa compétence. Voici donc :
Si, comme je le pense, la philologie est une science, elle permet de distinguer ce que les amateurs ne peuvent voir, ainsi que de deviner ce qu’ils ne peuvent augurer. Conformément à ce que j’ai écrit par ailleurs, c’est l’apanage d’un professionnel de savoir et de prévoir. Aussi, pour ne pas indûment se vanter, il lui faut régulièrement faire la preuve de sa compétence. Voici donc :
Benjamin Whitmer est alcoolique.
Le succès subit qu’il rencontre va aggraver son mal.
Il essaiera d’écrire un livre supérieur en s’abstrayant de ses problèmes ; ce livre sera de toute évidence son apogée.
Après cela, il ne produira qu’une soupe populaire selon les mêmes ingrédients. Il se sera prouvé qu’il pouvait réussir une œuvre, et ambitionner de faire davantage lui communiquera le désir d’aller boire un verre plutôt que celui d’essayer. N’importe, ça se vendra quand même. Logiquement, des producteurs exigeront qu’on en fasse des films. C’est probablement même déjà acheté, si on y réfléchit.
***
Je situe Whitmer au confluent de trois sources – mais il m’en manque sans doute, et je ne vais pas m’abandonner à la facilité d’écouter ce qu’il en est dans ses interviews. Il y a d’abord Edward Abbey avec surtout The Cowboy pour la dimension mystique et survivaliste – mais on me dira que c’était facile puisqu’un personnage du roman le cite, je l’avais pourtant reconnu avant la citation et je dirai comment. Il y a First Blood de David Morrell pour le contexte post-Viêtnam, le procédé de l’alternance de point de vue et la montée progressive et inéluctable du cataclysme. Et il y a Le Livre sans nom, publié en 2006 de manière anonyme et ayant connu de nombreuses suites, qui, dans ses excès de violence et son côté « cool », pourrait aussi bien avoir été écrit par Whitmer lui-même (d’ailleurs, je viens à l’instant de regarder sur Internet, et l’on peut s’étonner qu’un écrivain ayant eu tant de succès avec seulement trois livres – et j’ignore ce qui, dans chacun de ses livres s’ils sont comme celui-ci, peut nécessiter un travail de trois ans – dispose d’une page Wikipédia aussi courte… mais enfin, je n’ai pas procédé à une étude comparée et je n’affirme rien ; je ne vais certainement pas relire Le Livre sans nom pour vérifier cette théorie – ça ne m’intéresse pas. J’ajoute que je découvre seulement maintenant, je le jure, que son roman Pike est en cours d’adaptation cinématographique : il faut vraiment, pour en arriver à ce point de systématisme si prévisible, que les réalisateurs plébiscités de nos temps soient au plus bas de la créativité et de l’imagination humaines.).
Évasion, qui est certainement la traduction la plus littérale possible de Old Lonesome (c’est ce titre original, au fait, qui m’avait permis de me figurer la filiation avec Abbey ; c’était alors selon moi un hommage explicite que l’écrivain rendait à son prédécesseur, mais l’éditeur s’en moque, y compris comme ici quand c’est le même qui publie en France à la fois Abbey et Whitmer : ne vous offusquez pas vous-même, quand vous publierez par exemple un ouvrage à la mémoire de votre chien Médor, que vos traducteurs américains l’appellent Woofy, et que vous vous retrouviez à vanter les mérites d’un animal totalement inconnu ; c’est une question de commerce, et admettez une fois pour toutes que vous n’y connaissez rien !) – Évasion raconte l’échappée parmi le blizzard du Colorado de douze détenus drogués et dangereux, la plupart psychotiques forcenés, que poursuivent activement des dizaines de gardiens armés hors de toute proportion et sous amphétamines, la plupart psychotiques forcenés, dirigés par un directeur nourrissant une insurpassable mégalomanie rehaussée de narcissisme pervers, chef incontesté en matière de psychose forcenée, le tout situé dans une petite ville désespérée et miteuse que l’auteur voudrait nous représenter un symbole de médiocrité américaine et où maints habitants seront pris en otage, la plupart dépendants, détraqués, névrosés, et donc eux aussi psychotiques forcenés. Ce contexte, qu’on devine, ha ! mais évidemment fort réaliste, est uniquement un, ha ! mais très louable prétexte à des débauches de sang et à des répliques décisives, débauches qui ne présentent jamais l’avantage de rendre une couleur soigneuse et crédible, et répliques qui, comme toujours en littérature, vaudraient surtout comme impromptus si elles pouvaient en être pour de vrai (mais seul un amateur succomberait à cette illusion que ce qui est dit ou fait dans la fiction avec le plus de synchronicité équivaut strictement à une heureuse coïncidence ou à une superbe répartie dans la vie réelle !). Ces deux procédés, chairs sanguinolentes et verve stupéfiante, tout d’artifice, la critique complaisante les assimilera sans doute aux superficialités juvéniles et défoulantes, goûtées par les adolescents sans recul qui nous servent de journalistes, de par exemple Tarantino ou des frères Coen. On a donc, selon le programme exactement prévu, sa ration de cervelles giclées, de vulgarités vraiment très cow-boy, d’accidents et de dynamite, de pus issu de plaies invaginées et d’actes de tortures imaginatives : c’est conforme, il faut se résoudre à « valider », et l’enfant-lecteur, après sa bande dessinée de The Walking Dead et je ne sais quelle série sur des vikings surhumains mais quand même sympathiques, retrouve une variation de ses héros favoris de caricature, comme dans les Marvel qui figurent le parangon d’une littérature écervelée et divertissante, de l’essence de la littérature, de ce pour quoi de toute éternité elle est supposée être conçue, à savoir le jeu et les sensations. Il faut que ça épate. De l’action et des cris. Que ça en jette. Du visible abrutissant. Qu’on oublie toute pensée, cette réflexion qui encombre et qui nuit. En un mot, du sur-mesure pour notre époque d’épiderme.
D’un point de vue philologique, ou, pour le dire autrement, en se plaçant du point de vue de l’écrivain, il n’y a manifestement pas une situation du roman qui ne soit écrite dans le but essentiel de provoquer perpétuellement ce genre d’attendus insubtils, de ces retournements incessants qui empêchent tout simplement que les évadés se comportent avec intelligence et froideur, les otages avec une crainte respectueuse, les gardiens avec professionnalisme. Nul ne peut croire que c’est vraisemblablement que l’action se situe en 1968, ni qu’elle se situerait en 1898, ni en Amérique à n’importe quel âge de l’humanité, ni sur Terre dans notre dimension et probablement dans aucune des autres selon tous les principes de la vraisemblance en usage pour juger d’un roman. Les personnages sont déments et complètement désinhibés, dépossédés de leurs scrupules au même titre que s’ils appartenaient à une autre espèce : leur déshumanisation ne se définit pas comme le résultat explicable d’un processus, il ne s’agit pas d’une mentalité élaborée, d’une construction spécifique, c’est plutôt seulement comme si cette ville du Colorado avait souffert une apocalypse qui l’avait laissée durant des décennies à l’état d’isolement et de sauvagerie, quoique, certes, en trouvant la nécessité de conserver vers les montagnes un centre pénitentiaire (qui croirait que cette présentation fidèle puisse convenir à dresser le portrait d’une ville américaine de 1968 ? Ce « 1968 » sert d’excuse : « Ils étaient tous à moitié fous, n’est-ce pas, puisqu’ils revenaient du Viêtnam ?! On peut donc raconter tout ce qu’on veut ! » Oh ! c’est si merveilleusement fin !) Comme souvent dans les romans américains ou « à l’Américaine », le lecteur est forcé d’accepter une à une toutes les énormités qu’on lui fait avaler, il doit admettre absolument tout, il n’a certainement pas le loisir de réfléchir à la possibilité ou non de cela, et s’il n’avait que la curiosité de s’essayer au sens du discernement, il sentirait aussitôt que c’est à peine une intrigue qu’il lit, qu’il ne fait qu’ingurgiter depuis de trop longues minutes une suite de situations décontextualisées et maintenues à l’état de vie artificielle que par l’obligeante oblitération de ses facultés mentales. Mais quelle raison a-t-il d’être si obligeant ? Eh bien ! il n’a jamais pensé qu’un livre était l’occasion d’être exigeant, voilà tout ! Quel critère d’abord aurait-il de ne pas aimer un roman noir, un roman d’action ? Interrogez autour de vous : jamais un thriller n’est mauvais pour lui, mais il y en a « qui sont meilleurs que d’autres » – bien qu’on ignore toujours sur quels fondements ! « Ça se sent ! »
Pire : ce que je devine en spécialiste c’est-à-dire en romancier et en critique littéraire, c’est que Whitmer, lancé dès le commencement dans une surenchère galvanisante de tensions et de chocs, longtemps ne parvient pas à rattraper cet effet initial de saisissement, il perd cette dynamique vers la page 150, il le sait et tâche à rehausser l’émotion qui glisse par des péripéties adventices qu’il teinte d’éléments de psychologie et de flash-backs comme toutes les fois que les scénaristes n’ont temporairement plus d’idée et atermoient l’intrigue (cette psychologie alors est par ailleurs tellement convenue !), rompant le rythme enlevé de l’histoire qui faisait à peu près tout son intérêt, et il poursuit ainsi sans savoir où ou du moins sans conception claire des transitions, mu pour une fois par des linéaments de logique qui font tout à coup pâle figure, en redoutant qu’autrement chez son lecteur poigne l’ennui. Mais il ne fait aucun doute qu’il s’ennuie un peu lui-même, il fait de la page du mieux possible, s’assoupit en conscience, espère l’inspiration par fulgurances, mais incapable de se concentrer pour planifier quelque chose, il écrit quand même en attendant, et c’est là qu’est l’erreur, en cela précisément on distingue un auteur alcoolique parce que c’est celui qui se laisse aller, qui n’a pas la force de retenir son stylo pour déterminer un moyen et une astuce, et qui, pour compenser, ramollit son action, dissout sa force de construction, tâche à noyer son malaise dans une certaine permanence. Partant, tout ce qui lui reste à faire, c’est de déplacer ses personnages, mais dans un périmètre restreint à cause des contraintes de son action (la neige, dont on pourrait dire qu’elle fait de ce récit un huis-clos s’il y avait le moindre nécessité que c’en fût un, au lieu que, chose assez ridicule, nos courageux évadés ont l’opportunité, pendant 400 pages, de courir peut-être moins de cinq cents mètres), et, pour « remplir », il mêle à cette irrationalité de fausses élaborations philosophiques qui, sensées et longuement muries chez Abbey, servent ici à faire hermétique et sage dans l’espoir d’une véritable action. C’est ainsi que Whitmer ennuie son lecteur-cible avec le récit de Dayton, cousine du prisonnier Mopar, qui passe le plus clair de son temps à ne rien trouver, mais, certes, un peu partout, ou avec le duo des journalistes qui, assez superflus en tant que fonctions et que particularités (ils ne servent bientôt qu’en tant que gardiens de plus pour participer à la traque), n’entretiennent même qu’à peine un rapport avec l’information et la vérité, leurs symboles ; ces personnages constituent un « truc d’écrivain », une manière de « retombée » pour le contraste de façon qu’en interposant des souffles factices et à peu près vides l’auteur se laisse plutôt le temps de chercher des idées que de proposer, à son lecteur, quelque alternative à la furie qu’il n’est plus capable de suivre avec la même frénésie.
Après ce que j’ai écrit, évidemment, un lecteur complaisant – ou disons : plus indulgent que moi – me trouvera injuste de ne pas parler des « thèmes » sous-jacents au roman, cette collection de thèmes qu’on se plaît à fouiller dans toute œuvre même mineure par obstination à vouloir décidément en dire quelque chose, thèmes parmi lesquels on rencontre ici : la prison comme phare d’éternité pétrifiante immobilisant une ville entière dans un métier de surveillance et d’attente ; l’enfermement des êtres conditionnés et entravés par leur environnement piteux de campagne et d’hérédité ; la pauvreté et les brutalités tapies fondant une existence de routines atroces et dégénérées ; la jonction fatale des tensions individuelles qui déterminent par à-coups imprévisibles un glissement et une destinée terribles ; enfin, la nature sauvage en ses montagnes enneigées, mais loin, infiniment loin derrière Abbey, et qui constituent un paradoxe de liberté et d’entrave : toutes ces approches sont certainement justes mais traitées avec trop de négligence pour susciter de la profondeur – ce sont des dépôts inexploités, pareils à quelque poudreuse presque aussitôt fondue, qui forment la trame d’une identité mais n’ayant pas réussi à se figer durablement, sans cette force d’une vision matérialisée, presque hasardeuse au fond, comme le sillage involontaire d’un parfum ; en somme, de l’homme, comme toujours, mais pas de l’art : la neige est passée, on n’en voit plus rien, il n’en reste qu’un insaisissable souvenir de neige, c’est même trop peu en totalité pour être sûr qu’il y a eu rien qu’une intention de neige…
Enfin, n’importe ce que j’en dis de bien ou de mal, c’est un livre, comme les suivants de cet auteur, qui assurément « marchera », et quand notre époque opportuniste aura pressé ce Whitmer encore un peu neuf jusqu’à épuisement complet et affaissement incurable des facultés mentales, elle en comprimera à son tour un autre plus à la mode et prétendra que le premier n’était pas son problème puisqu’après tout elle lui a prodigué l’argent. Le pire après cela, c’est que c’est moi, à côté, qui aurai passé pour intransigeant et cruel, et qu’alors on me fera porter, entre autres « représentants », la responsabilité de cette pathétique déchéance comme si j’étais le monstre insensible qui y avait principalement contribué.
À suivre : La tache, Roth.
***
« Warrington descend bruyamment l’escalier avec ses grosses chaussures d’uniforme. Il pose deux armes sur la table basse. Doucement. Comme si elles étaient faites en verre.
Le cœur de Mopar se vide de tout son sang direct dans l’estomac. C’est un revolver à brisure calibre .38 qui semble ne pas avoir servi depuis la Première Guerre mondiale, et une .22 long rifle à levier de sous-garde au canon rouillé et piqué de corrosion.
— C’est tout ? demande Howard.
— C’est tout, dit Warrington.
Howard ne prend pas la peine d’attraper l’une ou l’autre des armes.
— Et pour les munitions ?
— Il y a quatre balles dans le .38 et j’ai trouvé une boîte de 50 pour la .22. Y en a douze qu’ont déjà été tirées, ceci dit.
Howard se gratte le bouton qu’il a entre les yeux.
— Si on se retrouve coincés avec ces trucs, autant prier pour que les flics meurent de rire.
— Toutes nos excuses. (Alice arrive avec un plateau à café en argent, Murray la suit avec une serviette à thé sur l’épaule.) La prochaine fois qu’on se fera prendre d’assaut par un gang de dégénérés, on fera en sorte d’avoir un arsenal décent à proposer.
— Si tu veux qu’elle continue à respirer, dit Howard à Murray, va falloir que tu songes à faire fermer sa gueule à cette connasse.
Murray le regarde en clignant des yeux. Lui faire fermer sa gueule ne paraît pas être une idée totalement étrangère à son esprit. Il a juste de l’air de n’avoir jamais trouvé comment s’y prendre. » (pages 92-93)




/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/image%2F0404497%2F20240421%2Fob_aefb28_coeurs-cicatrises.jpeg)