Revue Bifrost, n°105, 2022
Il est un ton spécifique à certaines revues héritées du pulp – bien que le papier lui-même ait beaucoup changé –, avec leurs couvertures criardes et un peu puériles, leurs intitulés obliques et bigarrés comme des appels publicitaires, conservant les codes admirés d’une époque révolue, entretenant la nostalgie d’un entre-soi d’adolescent, lorsqu’elles s’attèlent à la culture populaire. On y trouve, comme dans Bifrost, « la revue des mondes imaginaires », revue consacrée plus particulièrement au genre de la science-fiction, un mélange de légèreté critique horripilamment familière et d’expertise extrêmement pointue, par exemple quand un rédacteur mentionne en un lexique complaisamment nonchalant et « sympathique » des références érudites, confidentielles et devenues indisponibles.
Bifrost, c’est un peu Albert Einstein qui vous tire la langue. Seulement, un lecteur qu’on respecte ne sent pas forcément le besoin qu’on lui exprime combien la physique quantique ou la science-fiction, c’est cool et branché, ou épatant, ou fandard, avec le costume démesurément mal ajusté caractéristique des conventions de fans de jeux vidéo et de séries télévisés. Je n’aime pas cette racole familière. On dirait de ces amateurs immatures et spécialisés qui ne savent pas s’habiller ni se comporter. Je préfère, moi, que la vulgarisation, si elle est nécessaire, émane de quelque intelligence supérieure qui se met à portée de l’individu perspicace, sans présumer qu’il doit s’adresser à nous comme si l’on avait quatorze ans.
La revue est séparée principalement en un court recueil de nouvelles, plus un carnet de critiques de livres de parution récente, plus un dossier présentant un auteur estimé remarquable pour son apport au genre de la science-fiction.
Parmi les quatre nouvelles ici proposées, trois sont américaines, une seule française : or, je trouve a prioridommage qu’une revue française soit incapable de présenter en priorité des récits nationaux, ce qui inviterait à découvrir de belles plumes patriotes et à opérer une véritable recherche littéraire sur son territoire plutôt que de se contenter de republier des récits déjà passés d’assez grandes gloires étrangères ; mais comme les américaines sont de loin les meilleures, il n’y a peut-être pas lieu d’inciter le directeur de Bifrost à publier des textes de qualité médiocre s’il faut que les français soient tels. C’est qu’en l’occurrence les trois nouvelles américaines ont au moins l’avantage élémentaire de raconter une histoire et de tenter de présenter une chute, ce que Laurent Genefort n’a même pas tenté de faire, accumulant des situations sur un thème sous la forme de faits divers, linéaments d’une idée unique sans beaucoup de style et sans net effort de construction.
Je déteste qu’un auteur propose à des revues des travaux incomplets, spécialement s’il est déjà connu – ce qui semble être le cas : le Genefort n’étant pas daté, je présume qu’il est inédit. Je déteste aussi que les directeurs se laissent prendre à cette notoriété en y perdant leur sens critique. J’y vois un double mépris : on dirait d’une part que l’écrivain recycle ses « fonds de tiroir », proposant des récits manifestement manqués ou anecdotiques qu’il n’a pas su placer chez les éditeurs, d’autre part que les directeurs ont abaissé leurs exigences jusqu’à publier des textes frelatés issus de célébrités vendeuses tandis qu’il y a peut-être tant de talents nouveaux à lancer et à promouvoir dont les textes attendent et s’amassent en piles sur le bureau du secrétaire (je viens de proposer une de mes nouvelles à la revue, on verra bien – oui, mais pourquoi donc ai-je cette habitude de commencer par avoir l’air d’invectiver ceux que je sollicite ?)
Les récits américains sont d’une cinématographique assez typique, c’est-à-dire que leur technique de représentation est irréprochable mais que, comme souvent, leur profondeur laisse à désirer. Ils captivent avec force, ouvrent des suspenses plaisants et faciles à lire, maîtrisent les enchaînements de scènes et incitent efficacement le lecteur à poursuivre, mais ils tolèrent mal l’esprit critique, l’esprit de distance, l’esprit d’art : ce ne sont que des divertissements. Le récit d’Eric Brown de 2013 (mais pourquoi republier un Brown ?) met en scène un Sherlock Holmes se penchant sur l’assassinat d’un Martien, néanmoins c’est de toute évidence que son enquête est sans envergure, ses indices piètres, sa résolution sans originalité, et l’intrigue pensée en un quart d’heure, très loin en tous cas des pertinences curieuses et distinguées de Doyle auquel la médiocrité conceptuelle de Brown ne rend pas du tout hommage. J’avais déjà remarqué ce problème récurrent chez la grande majorité des auteurs ayant publié en quantité en magazines, y compris dans les années où le pulp était à la mode, comme ce fut particulièrement le cas dans les genres de l’imaginaire : leurs écrits sont très inégaux, parfois même honteux d’indigence et nettement alimentaires, hâtifs et négligés, proposés même selon l’ordre de notoriété des revues à mesure qu’ils ont été refusés ; ce sont des « tant bien que mal » abandonnés aux lecteurs en attendant le temps d’un travail consciencieux et d’une inspiration vraie. C’est incontestablement que ce Brown est insuffisant, sauf à être habitué à cette sorte de distractions évanecsentes : le déroulement est sans effet, le dénouement sans surprise, le personnage sans finesse ; on dirait… on dirait typiquement un Holmes finement britannique interprété par un Américain grossier qui aurait été incapable de concevoir et d’analyser ce qu’il y a de particulièrement subtil dans une intrigue de Doyle.
Le Leigh Brackett est moins superficiel et plus envoûtant, plongeant le lecteur dans la situation de Martiens établis sur Terre et violemment discriminés par de révoltants et stupides provinciaux racistes et rustres : certes, la tension est lourde et émaillée de jolies descriptions, et elle se résout en une dure sensation d’injustice poignante… n’empêche que ça reste seulement l’histoire d’une agression xénophobe appliquée à des aliens. L’idée tient en peu de réflexion en dépit de l’excuse selon laquelle Brackett rédigea la nouvelle dans les années 50 et dénoncerait en contexte davantage qu’un lynchage extraterrestre. Mais l’inconvénient majeur de l’intrigue, c’est qu’on peut appliquer la même situation à une grande variété de personnages et dans une multitude de décors avec un semblable manichéisme pour susciter un tel sentiment de cruauté : c’est quasiment une « recette » narrative, transposable partout. C’est ainsi sans génie, quoique non sans une certaine élégance : l’auteur brode sur un canevas largement repris et usé ; c’est quasiment un palimpseste, la redite de n’importe quelle banale histoire de harcèlement dont la tension éclate en violence ignoble.
Le Ray Nayler daté de 2020 (enfin proche !) vaut, lui, un peu davantage : c’est l’histoire, rétrospectivement racontée à la première personne, d’un garçon dont le père mort à la guerre a été un temps remplacé par un robot. Inévitablement, la complicité entre l’enfant et la machine évoque le célébrissime « Robbie » de Les Robots d’Asimov, et il est dommage qu’avec si peu de connaissances en science-fiction je sois déjà en mesure d’en repérer la référence et donc, en partie, l’inspiration, pour ne pas dire l’imitation. Cependant, si le principe de la nouvelle est un pastiche, je ne suppose pas ici qu’avec une pareille idée, générale et féconde, et qui peut réaliser toutes sortes de conclusions opposées selon l’auteur et le style – idée d’ailleurs probablement reprise de manière large dans la littérature de l’imaginaire et sans doute par Asimov lui-même –, idée de l’affection entre êtres d’espèces distinctes, on ne puisse former des intrigues variées et moralement perspicaces et troublantes, tandis qu’avec Brackett il était presque inévitable que le récit sombrât dans la facilité et la resucée tant la morale était platement convenue. Et, certes, Nayler parvient à multiplier les scènes non seulement avec l’habileté d’un écrivain américain rompu à la technique narrative, mais en y instillant au surplus de précautionneuses touches de sentimentalité, suivant l’assez agaçante doctrine du « Show don’t tell » dont j’ai déjà parlé et qui rend les auteurs français en général si dociles et peu profonds. En sorte que le récit est fort bien narré, même si à la vérité on n’y trouve que de légères marques de personnalité stylistique – les Américains historiquement se risquent peu au style, quand les Français, eux, en sont devenus incapables, insoucieux ou indésireux. Le récit se construit ainsi en menant progressivement à une chute, et plus j’en relis d’extraits, plus j’y trouve de finesse, quoique plutôt des suggestions d’émotions poétiques que de véritables innovations sentimentales. Enfin, c’est d’une propreté, d’une « eau », qui mérite la lecture, limpide et pragmatique. Seulement, Nayler n’y a pas trouvé de chute, au point qu’on se demande à la fin si l’on n’a pas raté quelque chose : rien vraiment ne justifie l’écriture de cette nouvelle en fin de compte, je veux dire que l’auteur n’est pas parti avec une révolution en tête, qu’il n’a pas aspiré à une œuvre, de sorte qu’à mon sens exigeant il n’aurait pas dû commencer à écrire ; c’est assez tendre et bien fait sans doute, ce n’est pas encore supérieur quant à l’idée initiale, ce n’est pas écrit avec rien qu’un soupçon de haute vertu (car enfin il n’est pas question pour moi qu’un récit relève toujours du génie, mais une intention, du moins, doit y tendre, avec rien qu’une idée singulière). Une promesse dont on garde la saveur d’expectative, mais dont on oublie le dessein et la destination. Artisan, artiste en quelque sorte, mais point ciseleur profond.
Dans Bifrost, la seconde partie de critiques littéraires a, autant pour un novice du genre que pour un spécialiste du commentaire comme moi, quelque chose de comique et d’effarant.
« Comique » en ce que, dès le résumé des livres, je m’aperçois combien les auteurs de science-fiction vont chercher d’idées stupides, stériles et consternantes, purement décoratives et outrageusement complexes et ridicules, inutiles. Exemple que j’invente en improvisant, pour en donner le ton : La planète Grumel abrite une espèce de créatures adorant le Dieu-tempête Karama qui doit bientôt réaliser une prophétie attendue depuis des millénaires et destinée à changer le cours de l’univers. Mais les voyageurs de l’espace, Gronk et Makkhrâ, amants dotés de pouvoirs mentaux exceptionnels et mus d’un profond désir l’un pour l’autre, se posent sur Grumel et devront affronter la destinée maudite de la planète à laquelle ils vont se découvrir inextricablement liés. Quoi ? croyez-vous que j’exagère, tant c’est lourd et alambiqué ? Il faut donc que je cite au hasard à titre de preuve et démonstration ; voilà : « On découvre tout d’abord la yaotlek Neuf Hibiscus (Malva, pour les intimes) à bord de son vaisseau, voguant aux confins de l’Empire Teixcalaan allant au-devant du danger alien prophétisé par Mahit Dzmare. » (page 99), ou : « Née de l’éclatement de l’URSS, la République indépendante de Mertvecgorod est une excroissance scrofuleuse défigurant le paysage de l’Europe orientale, un cancer rongeant de l’intérieur le corps social, une zone de non-droit dirigée par un quatuor d’oligarques corrompus et pervers. » (page 106), ou encore : « Des tréfonds caverneux de Gemma la glacée, où il avait été enfoui par la civilisation des Bâtisseurs pour préserver l’univers de sa fureur destructrice, le Dévoreur a jailli avec violence, poussant les humains survivants et les Timkhans, extraterrestres à l’origine de l’enfermement du monstre quantique, à s’allier pour enrayer la menace. » (page 113) L’effet de parodie est pour ainsi dire authentique, à peine ai-je besoin de me moquer tant les résumés parlent d’eux-mêmes ; on devine une foule de désœuvrés à claviers Macintosh qui écrivent presque n’importe quoi en se figurant sur les brisées de Robert Howard ou de Frank Herbert : c’est le règne de l’imagination auto-justificatrice, du roman contemporain populaire dont toute légitimité repose sur le fait que l’auteur a laissé vagabonder son esprit et qu’il y a des lecteurs pour aimer ça, créativité qui est supposée, depuis des décennies, consister en une vertu cardinale, sans distinction de sujet ou de style, à savoir : raconter presque d’instinct et sans souci de vraisemblance l’intrigue la plus exotique fondée sur les conventions les moins audacieuses de sentiments humains mièvres et rebattus. Pas un talent a priori ou presque : c’est bien vrai, finalement, que la profusion de « F and SF » distingue mal, éditeurs comme lecteurs, la qualité d’un roman ! C’est seulement fait pour tourner de la page, mais c’est si décousu et si peu réfléchi que ça vaut les récits pour plage que les GaFlam vendent selon des moules préécrits sans aucun scrupule ; c’est même probablement à peine du livre au sens de littérature au lieu de dépaysantes anecdotes. Je pense que les amateurs du genre, qui, ainsi que moi, ont tant déploré d’être injustement dépréciés comme s’adonnant à des œuvres de « sous-culture », devraient au moins rendre un effort de sélection critique pour contrecarrer cette impression de délires faciles qui, pour l’essentiel, semble parfaitement avérée, à de rares exceptions près ; tous les catalogues des éditeurs spécialisés, à ce que j’ai vu, regorgent de ces insignifiances bavardes et défoulées, bizarrement chinoises dès le synopsis. (Il n’y a qu’un seul ouvrage parmi les 36 présentés qui a éveillé mon intérêt, c’est un recueil de nouvelles intitulé Fournaise de Livia Llewellyn.)
Et « effarant » en ce que les critiques comprises dans ce numéro, presque toutes d’une indulgence coupable (mais il faut préciser que Bifrost est la revue des éditions Le Bélial’ qui ont certainement intérêt à ne contrarier ni concurrents ni potentiels futurs auteurs), sont d’une similitude stylistique que je ne croyais pas possible en les admettant issues de commentateurs différents (mais j’en doute, à vrai dire : j’ai supposé en lisant que plusieurs pseudonymes utilisés appartiennent à la même personne associée à la rédaction). Leur format très court, que j’estime à moins de 700 mots, est une contrainte qui explique peut-être une partie de leur ressemblance ; pourtant, on doit constater qu’aucun de ces critiques ne tâche à se distinguer dans cet exercice, que la structure de leurs articles est fâcheusement répétitive, que leurs opinions ne sont presque jamais étayées même grossièrement, que leurs conclusions relèvent souvent de mauvais effets d’ouverture assez plats et automatiques, que leur manière trop détendue, imprécise et semblant chercher par ce ton d’amateur à excuser leur prétention à la publication, importune un chercheur de vérités et d’art, et que ce sont en somme plutôt des billets d’humeur extraits du courrier des lecteurs que des synthèses approchant, même de loin et en condensé, l’intérêt d’exactitude de critiques littéraires.
Le dossier, portant sur Leigh Brackett est, lui, complet et érudit sans excès, rédigé par des spécialistes, si ce n’est que ce qui est stipulé sur cette auteur n’est nullement de nature à en donner le goût à un esthète perfectionniste comme moi : Mme Brackett fut manifestement une abandonnée d’imagination qui écrivit à toute vitesse des récits sans considération éthique ou esthétique, et dont l’inconstance, admise même à quelque endroit de la revue, incite à penser qu’il ne s’agit pas exactement d’une artiste au sens noble. L’interview finale qu’elle donne avec son mari lui-même auteur de science-fiction (Edmond Hamilton) est en cela très éloquent : on y découvre que c’est qu’elle n'a rien à dire sinon qu’elle s’efforce à être heureuse en écrivant et en assemblant tant bien que mal des situations fictives, sans souci que de réussir à vendre ses textes, souvent à la commande. Ce fut une femme pauvre d’ambition comme probablement le furent beaucoup d’auteurs du genre, et l’on trouvera de façon flagrante si l’on y concentre son attention que toutes les questions potentiellement profondes ou polémiques qu’on lui adresse sont résolues en légèretés, en lapalissades et en consensus, à la manière de ces boomers qui aspirent surtout à ne rien dire d’important ou qui puisse perturber, même si l’on devine que la pratique régulière de l’écriture a forcément contribué, à la longue, à une certaine maîtrise au moins technique de son métier d’écrivain.
Enfin, je reçus l’excellente surprise, en revanche, à la lecture de ce numéro, en l’espèce de deux illustrations d’un certain Matthieu Ripoche, dessinateur français, qui a su comprendre et interpréter fort à propos deux nouvelles initiales en des noirs-et-blancs justement adaptés et efficacement suggestifs. J’ai salué son intelligente créativité sur sa page Facebook que je vous incite à consulter, et je la souligne à nouveau comme d’un individu pertinent lecteur et capable de réels choix artistiques. Si j’avais à élire un graphiste pour la couverture d’un de mes romans, pour l’instant c’est assurément lui que je choisirais pour me présenter ses suggestions.
P.-S. à destination de M. Ripoche après qu’il aura lu ces dernières lignes : N’espérez rien tout de même : les éditeurs, dont j’ai dit beaucoup de mal, me détestent ou me détesteront aussitôt qu’ils auront aimé mes textes et voulu savoir par ailleurs ce que je puis avoir dit d’eux – par conséquent ils ne me publieront point sans doute, ainsi n’aurons-nous certainement jamais l’honneur de collaborer.


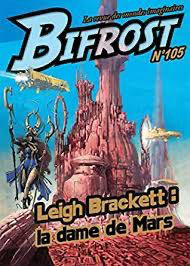


/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)