Les conséquences politiques de la paix, Jacques Bainville, 1920, ou Le lointain souvenir de la perpétuité des guerres
Notre époque, largement post-historique comme je l’ai remarqué ailleurs, n’a peut-être pour longtemps plus rien à raconter et à prévoir. On la voit, ridicule, se confire exclusivement aux infimités de la narration du présent si pauvre en troubles, avec ses problèmes dérisoires, ses anti-événements, ses embarras relatifs non à des dangers ni à des risques mais à des nuances de confort. Comme elle n’a plus de raison d’avoir peur, elle se fabrique des motifs d’inquiétude, et, sans distance pour s’apercevoir de sa supercherie, sans à-propos ni mesure relative, elle agit comme si ces craintes étaient réelles et le péril imminent. Tous ses soucis consistent dans la foi de leur existence, dans la psychologie de l’excitation de la crainte, fictive et comparable à l’émoi d’un film, et dans la bonne conscience d’avoir bel et bien des problèmes à traiter. Autrefois, on redoutait une invasion étrangère, des barbares étaient à vos portes, vous risquiez la mort ou la famine ; à présent, on vous met en garde contre la chaleur ou l’on vous enjoint à dépenser moins d’eau. Il n’est pas difficile, je pense, de comprendre qu’on distingue deux modes radicalement opposées de l’oppression mentale et de la lutte.
La façon même dont on « fait la guerre » est à peu près un simulacre : c’est un reliquat joué, mal souvenu, stéréotypé, de guerres anciennes et vraies, pas intériorisées, superficielles, réinterprétées par des amateurs, du cabotinage. La France déplace de petits corps de troupe dans des pays où elle n’a guère d’adversaire, réalise un « déploiement » c’est-à-dire qu’elle cantonne ses unités dans des bases sûres, effectue des patrouilles et des « opérations » qui ne sont pas des batailles mais principalement des opérations de surveillance. La France par son armée n’arbitre des litiges qu’aux lieux où ces litiges n’entraînent presque aucun opposant : c’est tout justement en ces endroits qu’elle s’installe. Et il lui meurt presque autant de militaires dans des exercices que contre de véritables ennemis. Notre nation joue à la guerre plutôt qu’elle n’en fait. Quand le président français parle de la guerre en Ukraine, il fait de la communication, prend une mine sévère, mime l’homme viril selon l’exemple qu’il trouve, montre comme il est intransigeant et responsable, en vérité il ne touche pas au commencement d’une préoccupation de guerre : c’est une guerre qui n’en est pas une, notamment parce qu’elle se règle par l’argent, parce qu’il suffira toujours de prêter ou de donner de l’équipement à des pays en guerre pour obtenir d’eux le droit de parler de la guerre, de se targuer sous leur accord de cette préoccupation. La France a besoin d’affecter la guerre pour avoir l’air de la faire : elle se présente en puissance concernée, et à la fin elle paye. C’est tant mieux : l’esprit de guerre a disparu au profit des insignes, des attributs de la guerre postiche. M. Macron revêt tel sweat au logo d’un commando de parachutistes, omet de se raser pour la photo dans un faux Quartier Général de Campagne dont le bureau en acajou est damasquiné d’argent, le voilà endossant le rôle d’un dux bellorum le temps d’une pose, et c’est comme devant une console de jeu se figurer une importance planétaire parce qu’on remue des troupes fictives sur des cartes imaginaires. Cette manière de feindre l’autorité et la menace serait indécente si elle ne s’inscrivait pas dans des mœurs habituées qui ne distinguent déjà plus la pantomime de la réalité brute. Le citoyen est d’accord, car il n’a pas davantage conscience du réel, toutes ses craintes sont imaginaires, exacerbées pour qu’il ait lui aussi l’honneur d’une grandeur et d’une responsabilité : le politique lui est conforme, il n’y a pas rupture entre eux, aucun ne peut corriger l’autre à son exemple. D’ailleurs, chez les deux, ce n’est pas proprement qu’on s’amuse avec la guerre, car personne ne trouve ça drôle : on se persuade plutôt qu’on ne joue pas, et en effet on finit par se prendre au piège de son propre sérieux. Mais on n’a pas peur de la guerre : ce sont des peurs extrapolées, peurs au troisième ou quatrième degré. Ce sont des peurs qu’on légitime par des : « si… », et même par des « si, après que si et si… ». Il devrait exister, dans la liste des valeurs des temps, un conditionnel de la peur fausse, un conditionnel du conditionnel. Nos compatriotes vivent dans ce temps où ils n’existent point à l’indicatif, où ils se fantasment à la fois des périls et un être. Toute leur prétention à consister se conjugue en un moment et en un espace considérés comme hypothèses, mais ils n’existent pas. S’il faut dire à l’indicatif ce qu’ils sont, on ne rencontre qu’une expectative ou qu’une interrogation ; on ne sait pas. Si l’on cherche ce qu’ils craignent et quiest, on n’arrive à rien. Il faudrait un événement pour qu’il arrive (quelque chose), mais si cet événement arrivait, on ignore s’il arriverait bien quelque chose, car, à vrai dire, dans sa « préparation » du pire, on ne s’est même pas vraiment préparé à ce qu’un fait survienne qui oblige réellement à agir, c’est en toute théorie qu’on s’est « préparé », comme lorsqu’on rencontre pour la première fois de la fumée après des exercices d’incendie. Quand une infimité qu’on ne peut pas appeler un événement se produit, il n’advient par lui que des réactions négatives qui le rendent mauvais. Dans l’hypothèse, le Contemporain est vantard ; dans la réalité, c’est un crétin que la plus dérisoire peur instaure dans l’émotivité réactionnelle. Il n’existe plus ici de sentiment authentique de la guerre. Ce sentiment est une extrapolation justificatrice de la nullité contemporaine, de son incapacité à la distance. On ne sait pas au juste de quoi on a peur, on a peur très longtemps – des éternités – avant d’avoir mal. Quand on a enfin mal, on n’avait même pas prévu que c’était de ce mal qu’il fallait avoir peur et se prémunir. Nous vivons un temps qui n’a pas le souvenir, au surplus de la relativité du mal, de la vraisemblance de la guerre.
Je ne souhaite pas y revenir, à cette peur, ni invoquer, réincarner, actualiser la guerre ; il est trop heureux qu’elle ait cessé d’être, cette peur. Mais il me déplaît en toutes choses qu’on fasse semblant, en particulier qu’on feigne si mal : un bon acteur est au moins apte à quelque chose, et il sait au moins qu’il joue. Entretenir l’illusion d’une peur ne vaut pas la conscience que cette peur est illusoire ; or, on a oublié que nos peurs ne sont pas vraies, et cela, c’est de la mauvaise foi, c’est de la tromperie, c’est une perte du sens de la réalité et des valeurs. Quand on vit dans un jeu, on est mal placé pour porter des jugements sur le monde, tout nous échappe, on n’a plus aucun discernement, on ne voit pas tant qu’on se représente. On ne retrouvera pas le commencement d’une raison si l’on n’est pas capable de mesurer que nos affects, déjà, sont de purs enthousiasmes, des excès manifestes, des légitimations du néant intérieur : quand on se croit vivant et digne au prétexte de toutes ces agitations ridicules, on est sûr d’être pour l’instant mort et vil. Du moins quand toutes nos appréhensions sont imaginaires et exacerbées, c’est bien assurément qu’on vit dans un rêve : on a plutôt peur d’avoir peur, on est décalé d’au moins un degré par rapport aux phénomènes ; on vit dans de l’expectative supposée, on n’existe pas dans le domaine de l’être ou du faire. Inutile dès lors de prétendre se confronter au difficile : le facile déjà, ou plutôt l’inexistant, constitue une peur ; ne rien faire est un début d’angoisse, mais faire est une impossibilité, un effroi, une stupeur. La terreur panique serait alors l’indice de l’ombre d’une réalité. La réalité, c’est qu’il n’y a pour le Contemporain pas de guerre, que l’impression fantasmée de la guerre lui communique déjà une crainte énorme, disproportionnée.
Sans doute la dissuasion nucléaire a-t-elle altéré la représentation qu’on se formait des conflits armés : elle a introduit l’idée prééminente de guerre-au-conditionnel, après menaces et sanctions non belliqueuses, concept de « guerre froide » dont l’éclatement suffit à paralyser les esprits de craintes morfondues, entretenues, renouvelées dans les arts. Mais la sensation d’une guerre tangible, de souffrance et de fureur, s’est indéniablement éloignée au profit du concept de guerre : c’est pourquoi on a notoirement supprimé les frontières nationales devenues inutiles du point de vue de la défense, et pourquoi aussi la France selon maints rapports officiels et sans que personne ne s’en inquiète, ne dispose pour ainsi dire plus d’armée, son armée ne peut plus se livrer à la guerre véritable c’est-à-dire à des batailles lourdes et durables, ce n’est plus qu’une armée de parade chargée de prouver au monde que la France dispose d’une armée parce qu’elle en laisse des traces ici et là, ce qui est censé faire supposer qu’elle en garde ailleurs le principal : au même titre que les braises induisent l’idée d’un grand feu, le vestige d’une armée disséminée est censé évoquer la pensée de régiments vastes capables de s’abattre sur des continents. C’est cette vision que la France entretient, mirage qui est partie intégrante de ce qu’on nomme la « dissuasion » : menacer d’une fessée quand il ne vous reste que quelques doigts à chaque main. Les rares « interventions » de nos armées prennent la dimension d’événements capitaux : ce sont juste des escarmouches, mais qui rendent la légion d’honneur quand trois soldats meurent sous les balles de quelque indigène mécontent. Il faut que nos gesticulations minuscules soient des mouvements primordiaux sur une vaste carte d’État-major. Ainsi par exemple tua-t-on Ben Laden, oui mais sa femme, rapporta-t-on, « ne se laissa pas faire ».
Qu’on ignore à présent la guerre, je tiens à le répéter pour éviter tout malentendu, c’est pour moi tant mieux, il ne faut pas s’en plaindre : j’aime que la France n’ait plus à engager la vie de soldats. Seulement, j’aimerais encore davantage qu’elle ne fasse pas semblant de le faire. L’habitude qu’on a prise de jouer à la guerre m’incommode assez de vanité. Je me souviens par exemple que beaucoup prétendaient s’inciter à la peur et à la bravoure au début de ce qu’on a appelé « l’invasion russe » : à l’école de mes filles, leurs amies rapportaient que leur père était prêt à se battre pour éviter le péril national où les portes françaises étaient comme assiégées ; et après qu’une centaine de Français se soient présentés mercenaires aux frontières polonaises, tandis que nul de nos compatriotes ne réclamait spécialement un élargissement de la législation sur le port d’armes à feu (ce qui est toujours le signe d’une crainte qui commence à induire des conséquences un peu réelles), l’urgence plus grave car plus tangible des pénuries de moutarde et d’huile de tournesol les ont faire rentrer à la hâte, et la nation s’est enfoncée avec névrose en ce nouvel événement – les pères ont sans doute subitement converti leur grande préparation à la défense en recherche active de marchés noirs alternatifs aux grandes surfaces, quel héroïsme ! Il y aura vraisemblablement des suicides pour cela aussi : le désespoir en France se mesure non aux faits, mais au désir de les amplifier. Heureusement, le gouvernement décrétera un numéro vert, instituera possiblement des cellules psychologiques, et la canicule lui donnera prétexte à rétablir le sens des affolements justes et des terreurs saines !
C’est ainsi que lire Banville à notre époque relève presque de l’immersion dans un autre monde : pour un peu, ce serait de la fiction, du roman. Le roman est d’ailleurs devenu le point d’ancrage du Contemporain pour l’histoire, avec notamment sa passion pour la seconde guerre mondiale impliquant les décisions individuelles d’un grand-père ou d’une aïeule : mais que ça se soit passé est un alibi, le Français qui s’y intéresse le fait comme il se dépayse à n’importe quel récit, la réalité constitue seulement une facilitation de sa maigre capacité imaginative. Il se fait alors une idée abstraite de son rôle dans telle circonstance virtuelle, s’incarne, se « met à la place »… en général, il n’y a pas plus superficiel qu’un amateur de seconde guerre mondiale. Ce lui est surtout un moyen d’échapper à la monotonie prévisible du temps, tout en s’attribuant une fausse passion pour le concret, c’est-à-dire déjà presque pour une action. Mais il ne peut pas se figurer la guerre mondiale, il s’abreuve de mensonges complaisants pour s’octroyer un semblant de responsabilité : il lui faudrait, autrement, ne pas tant s’alarmer des motifs futiles qui le paralysent et terrifient, avoir compris enfin quelque chose à la guerre, à ses causes, à son déroulement. Une guerre chez nous… sans troupes, ni conscription, ni mort ? Par artillerie ou par drone peut-être ? La blague ! Affecter d’y croire ? La guerre est toute de représentation abstraite : on s’en forme au plus concret l’image d’une extension de conflits de bureau ou de voisinage. C’est exactement pourquoi il n’existe plus de conscience géopolitique, de conseillers de ce domaine et de cette sorte, de savants là-dessus documentés : il n’y en a plus seulement la nécessité, car la guerre n’est pas possible, et tous les pays en guerre sur bien des points ne sont pas de notre nature. L’Ukraine ne possède pas l’arme atomique, et c’est, malgré tout ce qu’on prétend, une manière de dictature, une fausse démocratie, son administration est autoritaire et corrompue au point que c’est à peu près une république bananière. J’admire – je parle ici par bravade ! – les experts notamment télévisés qui se livrent encore à des analyses géopolitiques : des spécialistes du rien, passionnés de l’inaccompli, universitaires de théorie toute pure. Jamais on n’en voit prévoir un fait français, mais ils parlent, se contredisent eux-mêmes et entre eux : on ne les discrédite jamais sur la fausseté de leurs diagnostics, on admet dès le principe que cela c’est du faux, de l’exercice, du passe-temps : rien que du spectacle. Ce qui arrive à la France, comme la hausse des cours du pétrole, ils le commentent quand c’est déjà réalisé, mais rarement l’ont-ils anticipé ; pourquoi ? Parce qu’il fait bien des décennies que leur fonction n’est plus de donner des conseils pour signaler ce qui va se produire : il n’y a en effet plus de « péril » pour rendre cette fonction nécessaire. Ils enseignent simplement, pour l’essentiel, des occurrencesexternes, le plus souvent au passé : « Il y a quelque chose qui a commencé à se passer là-bas : je vais tenir une conférence pour vous expliquer les tenants anciens et leurs aboutissants (pas les nôtres). Vous aurez l’impression, le temps d’un cours, d’être en guerre, et vous retournerez chez vous avec ce frisson et la sensation d’être concernés. » On rend des cours d’histoire dans un esprit identique, en supposant que ce qu’on explique n’est pas remédiable, pas applicable, fruit fatidique d’un « progrès ». Comme le rappelle Bainville en citant Louis XIV : on s’imagine « que le monde se gouverne de lui-même, par certaines révolutions fortuites et naturelles, qu’il était impossible d’éviter : opinion que les esprits du commun reçoivent sans peine parce qu’elle flatte leur peu de lumière et leur paresse, leur permettant d’appeler leurs fautes du nom de malheur et l’industrie d’autrui du nom de bonne fortune. » (page 13) À ces relations, on se crée une crainte qui remue un peu, rien de plus, mais qui n’aura d’effet ni au cœur ni à la périphérie de la mentalité. On se mettra devant la télévision pour passer l’inquiétude quand elle deviendra trop fascinante.
Bainville compte parmi ces intelligences révolues qui, pouvant prévoir des guerres parce qu’elles n’étaient pas bannies de conjoncture, se faisaient un devoir d’examiner et d’analyser les circonstances de la politique internationale : c’était utile alors, et instamment, car la guerre avait surgi et pouvait resurgir. Un seul homme alors, avec concentration et rigueur, mêm sans le ressort d’études spécifiques, un journaliste, osait ambitionner de mesurer les développements logiques d’une situation politique, comme le fit Tocqueville avant lui, et il lui fallait pour cela démêler des motifs et des forces par ordre d’influence, sans extrapoler à l’excès, sans exagérer des conséquences que la nécessité allait produire. Avec quelle méthode ? Rien que ceci : « Il y a pourtant des causes dont les effets sont tellement sûrs qu’il faut presque le vouloir pour ne pas en voir d’avance le rapport. Nous sommes donc partis, dans ce livre, du plus simple pour aller au composé, jusqu’aux limites où ce composé commence à se dissoudre dans un détail impalpable. […] Dans ce domaine, les certitudes sont toujours faibles quand il s’agit de prévoir comment tourneront définitivement les choses. Elles sont déjà plus sérieuses quand il s’agit de discerner le cours que les choses prendront. » (page 10) Qui aujourd’hui propose seulement la même tentative avec modestie ? Qui se livre à cet exercice d’anticipation ? À plus forte raison, où dans notre société rencontre-t-on un individu qui aurait intérêt à deviner l’avenir ? L’avenir chez nous est assuré quoi qu’il advienne, du moins il se présente comme tel à la conscience du Contemporain. Or, la science des augures est – était – une épreuve suprême de la compréhension humaine des êtres et des phénomènes : trier, impartialement et par critères, des données, les assimiler et apprendre, en établir les liens, s’en former à la fin par imprégnation si totale et juste une sorte d’intuition reconstituable en raisons, et pousser ses facultés jusqu’à concevoir dans l’avenir les glissements irréfutables de ces mouvements engagés, leurs effets et les premières réactions de ces effets. C’est ce que fit Tocqueville en prévoyant avec assez d’explicite la guerre de Sécession qui éclaterait moins de quarante ans plus tard.
C’est aussi ce que fit indéniablement Bainville en prévoyant les causes et les faits du début de la seconde guerre mondiale, en rapport avec les frontières, avec les alliances présentes et à venir, en rapport psychologique avec les sentiments patriotiques inspirés par le conflit, avec les logiques historiques et nationales des États formés et en construction, avec les premiers actes de ces États, et en rapport quasi technique avec les termes du défectueux traité de Versailles. Il sut calculer et prédire. Il signala en passant un trait caractéristique des conventions et des lois contemporaines : « Ainsi, les détails […] sont un travail d’experts et de techniciens. L’ensemble, les grandes lignes sont de l’ouvrage d’amateurs. De là lui viennent deux de ses traits dominants : un caractère moral prononcé car il est facile de mettre des lieux communs de moralité à la place du raisonnement politique qui exige un effort intellectuel et une préparation particulière. Ensuite un caractère « économique » non moins accusé qui s’accorde avec le moralisme puritain. Cette alliance n’est pas une nouveauté. Ici, elle a eu pour effet de primer toute considération vraiment politique. Le célèbre Economist de Londres concluait, le 5 juillet 1919, une étude sur la valeur du traité de Versailles par ces mots : « L’Allemand n’est pas naturellement belliqueux. Or, il vient d’apprendre que la guerre n’est pas d’un bon profit. Les États nouveaux ont encore à apprendre cette leçon : c’est le rôle de la Société des Nations de le leur enseigner. » Ces prodigieuses simplifications ne doivent pas surprendre. » (page 19) Quant à ces prédictions, je laisse le lecteur plus instruit que moi s’en approprier ou en discuter les visions saisissantes (voir par exemple ma citation après cet article). Mais c’est alors, je trouve, une exultation en même temps qu’un atterrement : Un homme au moins a compris avec vingt ans d’avance ce qui conduira au désastre, et il dit l’avoir découvert précisément sans élévation particulière, sans formation d’élite, sans prédisposition patente ni génie manifeste. On découvre que le nazisme a été minutieusement prévu – on le découvre après coup. Car il ne s’agit pas en l’occurrence d’un pompeux étalage de généralités interprétable et applicable à n’importe quelle guerre, et ce n’était point non plus le discours opportuniste d’un partisan ayant intérêt perpétuel au mauvais augure ou habitué à annoncer le pire dans l’espérance que le futur lui donnerait raison. Bainville n’exprima pas seulement avec mièvrerie que le traité de Versailles constituait une humiliation dont l’Allemagne voudrait tôt ou tard se venger, mais il indiqua la faute même de la reconnaissance de l’Allemagne comme État, ainsi que les innombrables imbroglios que les alliances et découpages territoriaux iraient provoquer. Les conséquences politiques de la paix n’est pas la peinture floue d’un vague température générale des relations entre les peuples ; c’est, point par point, l’explicitation argumentée du rapport des intérêts et des hiérarchies entre les Nations selon les lois de la généalogie et des causalités : ne pas mésestimer hâtivement un texte au prétexte qu’il semble avoir eu raison. Pour un peu, on croirait à un canular antidaté tant c’est oraculaire. Sensation de grandeur, certes, et puis impression de ridicule : se dire qu’on est à quai avec un ingénieur mécontent et inquiet pour assister au lancement du Titanic ; ne pouvoir rien faire d’autre qu’espérer que l’ingénieur s’est mépris contre l’armateur et contre le monde. Surtout, s’efforcer de ne pas voir ce départ stupide avec le regard de celui qui sait la fin : c’est trop péniblement terrible et fatidique. Ni les foules ni les politiciens n’ont écouté ; on a mal fabriqué le « bateau » comme cela, et puis on l’a laissé tel voguer sur l’eau à sa faillite. Tout ce qu’on peut dire après coup, c’est que « le devin n’avait pas l’air si sérieux »…
Une telle science des prévisions géopolitiques chez nous n’est plus logique ni possible ; quatre raisons au moins la rendent intempestive. La première est qu’on peut douter qu’il existe encore des esprits assez vastes pour la conduire, « assez vastes » c’est-à-dire moins qu’étriqués en ce que, sans être trop ardu, l’effort implique tout de même de prendre en considération une multiplicité de paramètres ; or, en général, ceux qu’on entend faire leurs prédictions ont eu tort sans se rétracter, s’efforçant de faire oublier leurs prophéties ou d’en atténuer la portée plutôt que de demander pardon de leur erreur et de tâcher de la comprendre pour ne la pas reproduire. La deuxième : notre civilisation ne dispose presque plus d’aucune philosophie de la vérité ; il lui importe peu qu’un individu ait annoncé une réalisation terrible qui ne s’est pas faite ou même qui s’est faite ; ce lui est un amusement, on estime que l’effectivité est plutôt un hasard qu’une compétence, et l’on ne tient ni rigueur de celui qui s’est trompé ou se trompe continuellement, ni ferveur pour qui prononce à répétition les « oracles » les plus systématiquement avérés. La troisième, c’est, comme je l’ai expliqué, que la guerre française ne frappant d’aucun caractère de vraisemblance, il n’est pas question de se livrer en vain à de tels travaux : cet effort est tout au plus un divertissement, au même titre qu’un mentaliste devine en public votre âge et le nom de vos parents. Et la quatrième raison, c’est que la somme des trois précédentes induit une telle mentalité d’insouci qui cependant réclame pour l’estime de chacun d’être quelque peu contrarié vers l’inquiétude, qu’un spécialiste de ces sciences des avenirs ressent toujours bien davantage d’intérêt à amplifier des craintes qu’à les estimer avec justes pondération et exactitude : une véritable géopolitique prédictive, et à vrai dire n’importe quelle science positivement prédictive, ne saurait s’accompagner du sacré « principe de précaution » qui chez nous ordonne d’exagérer toujours le danger d’un phénomène. Or, dans notre société c’est l’excès qui prévaut toujours : amplification de la menace et défection du sens rassis, voilà ce que la contemporanéité valorise ; il faut être enthousiaste ou ne pas être entendu ; subtil est au-delà du discernement moyen, cela discrédite et disqualifie, on n’écoute pas l’exact. La « distinction » selon nos mœurs consiste à se situer exactement à la mesure faible du Contemporain. On ne veut pas des esprits qui savent mieux que tout le monde, on réclame des figures homogènes aux allures d’honnêteté qui vous avertissent et sermonnent : la mièvre morale a priorité dans la reconnaissance collective sur la froide distance du génie impartial.
Comme je l’ai admis, je connais mal mon histoire, et les références de Bainville me sont souvent obscures : mais ce que j’ai vérifié sur les circonstances de la seconde guerre mondiale était bien établi dans l’essai sans qu’il soit besoin de forcer l’interprétation. Or, cela ne signifie pas encore que dans notre société la parole compte : prévoir ne présuppose pas qu’on peut ou qu’on veut empêcher ni même infléchir. Très souvent, l’obstination déraisonnable de gens bien placés qui tiennent surtout à n’avoir pas eu tort et sont en cela perpétuellement incorrigibles entrave tout effort de changement. Une patrie solidaire et fraternelle est un groupe obtus qui avance dans une même direction, estimant comme vertu de s’opiniâtrer ensemble, guidée par des « majorités » et des « progrès », sans souci de se tromper à condition que ce soit d’une seule vox populi. Bainville n’aura rien modifié à la guerre ; il n’est pas sûr qu’il ait été moindrement considéré pour son travail. Une discordance dans une nation, même juste ou supérieure, lui est toujours une humiliation et un empêchement : mieux vaut censurer ceux qui ne se réjouissent pas de l’unanimité « démocratique ». On peut prononcer tous les avertissements avec l’autorité de raisons irréfragables, rien n’influence la machine, elle va le rythme entêté qu’elle souhaite, et il n’existe que des incidents graves et arrivés pour la rediriger : c’est la faute de la machine qui refuse de distinguer, par leurs vérités, ses meilleurs, qui connaissent son fonctionnement et anticipent ses failles ; chez nous, il faut toujours que le train déraille avant qu’on le réforme, et les passagers diront ou bien que c’est la responsabilité de ceux qu’ils n’ont pas écoutés, ou bien, s’ils se rappellent leur vice, que c’était à d’autres d’en tenir compte.
Bainville fut de la nature inaudible de ces « lanceurs d’alerte » pertinents et sérieux, de ces grincheux monstrueux que déjà l’époque rejetait après la victoire : la vanité tolère mal les objections, particulièrement une vanité euphorique. Le journaliste admettait qu’il fallait réduire l’unité de l’Allemagne parce que ce pays, quand il était fort, avait coutume de transformer son orgueil en vindication. Inutile de revenir sur cette assertion peut-être dure mais qui s’est après confirmée ; « l’inhumanité » géopolitique de Bainville était fatidiquement sans recours, et voici comment je l’entends : il fallait qu’il fût permis à l’Allemagne, au nom d’un certain humanisme démocratique, de se reconstituer comme un État puissant, c’était là le sens d’un progrès qu’on n’aurait jamais osé démentir – personne n’eût trouvé la férocité coercitive d’asservir un peuple dans l’éparpillement et les particularismes « inhumains ». C’est ainsi malgré tout que la bonté contemporaine s’exprima dans le traité de Versailles en admettant de facto et de jure l’existence d’une nation allemande : c’était, selon Bainville, tout ce qui pouvait contrebalancer ses cruautés vénales et mesquines, et la raison pour laquelle le journaliste parla le premier d’une « paix trop douce pour ce qu’elle a de dur, et trop dur pour ce qu’elle a de doux ». On demanda réparation à un pays qu’on humilia, mais on lui fit en même temps l’honneur paradoxal d’être reconnu et unifié, et cette élévation accentua la sensation d’absurdité de la punition, injustice et vexation. On décida d’anéantir la force – militaire et économique – tout en rehaussant le sentiment de la force –, on releva la dignité et on poussa à l’indignation. Le reste, c’est de la vanité habituelle de vainqueurs : même Bainville ne sut pas voir qu’il est souvent préférable de s’empêcher, après un conflit, de faire du vaincu une victime expiatoire : il tenait lui aussi au châtiment des perdants comme un principe, c’était sa limite morale. Au moins les Américains de l’Union après la guerre de Sécession eurent-ils l’intelligence salvatrice de renoncer à exiger réparation aux Confédérés : c’était bien sûr la condition d’une entente et d’une réunification après la guerre civile mais, si l’on supposera qu’à ce mot de « civile » il faut mettre la particularité de cet étonnant armistice sans rétribution, on doit bien comprendre que même au sein des États-Unis une guerre fratricide présentait presque tous les aspects d’une guerre étrangère, ces États constituant autant de pays avec des présidents qu’on nomme là-bas gouverneurs, de sorte que ce « civile » abouté au mot « guerre » ne signifie à peu près rien, que tout était comparable encore environ cent ans près. Or, une curieuse rancune saisissait les triomphateurs après l’éclat et le feu : ils n’en avaient pas fini, il fallait mener les représailles, Clémenceau surtout réclamait l’humiliation, on cherchait l’exemple comme on frustre des enfants de vouloir « recommencer ». En France, on n’a jamais su faire dans le vrai pardon, sincère, vérace, pour soi-même ou pour les autres : même après la seconde guerre, il s’est surtout agi d’oublier et de travestir à dessein de ne pas donner encore l’impression « dure » de corriger. Il n’y a pas eu à excuser : c’est plutôt qu’on tourna les faits comme s’ils ne s’étaient pas produits ou comme s’ils avaient été fatals. Après cela, le repentir fut tout allemand, et ce fut presque une chance pour l’Europe – j’ose ce mot : une chance – que la faute fut alors rendue si patente et indiscutable après les déportations et des chambres à gaz, en ce que les facettes de monstruosité incontestable du nazisme servirent, servirent à soumettre le peuple allemand à la reconnaissance sincère de sa faute, sans quoi les revanches n’avaient plus qu’à se perpétuer tous les trente ou quarante ans. Sans doute aussi les suicides de Hitler et de ses principaux collaborateurs furent-ils des opportunités pour la paix durable, au même titre que M. De Gaulle ne voulut point tout d’abord du retour de Pétain et de ses justifications qui, à son procès, risquaient de réintroduire des clivages populaires : après ces dignitaires allemands morts, il n’y avait plus personne à rétablir, la nostalgie était vouée à l’échec, on trouva donc davantage de profit à se tourner vers une alternative à la rancœur. Peut-être suis-je l’un des seuls à avoir réfléchi à cela, à l’avoir exprimé aussi clairement, aussi justement et scandaleusement : la paix où nous vivons n’est due qu’à la rédemption sincère des Allemands et grâce à l’atrocité de la Shoah, bien que la bombe atomique, évidemment, ait aussi considérablement atténué, par le risque, le désir généalogique, instinctif, même atavique, d’en découdre parmi des Nations si disposées alors à s’entretuer, faute d’intelligence, de philosophie, et d’indiscutable progrès des mœurs.
P.-S. : Présentation très brève et excellente, dans cette édition, d’un Pierre Gaxotte dont le style rivalise d’excellence synthétique avec celui de Bainville. Après vérification, découverte que cette préface est à peu près contemporaine du texte, ce qui ne m’étonne guère, les préfaciers d’aujourd’hui étant au mieux sympathiques, au pire, et souvent, fort inutiles et impatientants.
À suivre : Mort à crédit, Céline.
***
« La marche de l’Allemagne est tout indiquée. C’est par l’Est qu’elle commencera sa libération et sa revanche. Si nous n’intervenons pas délibérément le jour où elle essayera de reconstituer sa frontière orientale, si nous renouvelons la funeste abstention de Sadowa, surtout si l’occasion choisie par l’Allemagne est propice, si la préparation diplomatique du coup a été habile, nous devrons nous résigner à agir seuls ou à peu près seuls et même peut-être à être désapprouvés. Cet isolement et cette désapprobation sont indiqués par le pacte de garantie qui a été ajouté au traité de Versailles et que n’ont d’ailleurs ratifié jusqu’ici ni les États-Unis ni l’Angleterre. Cette garantie nous est promise dans le cas d’une « agression non provoquée » et non dans un autre, c’est-à-dire qu’elle suppose une agression directe, lancée spécialement contre la France. Même alors, à moins que l’évidence ne fût aussi éclatante qu’en 1914, nos garants voudraient d’abord une enquête, des débats dans leurs parlements avant de se porter à notre secours. C’est dire qu’une agression bien machinée par une dépêche d’Ems ne nous ouvrirait aucun droit à cette garantie très conditionnelle. Quant à une agression directe, celle dont serait victime un pays ami et solidaire du nôtre (pensons toujours à la Pologne, si découverte, si exposée), quant à une annexion, même sans violence (comme celle de l’Autriche), qui accroîtrait dangereusement le territoire et les forces de l’Allemagne : tous ces cas-là, dont nous aurions pourtant à supporter les répercussions si nous demeurions inertes, rentreraient dans la catégorie de ceux où, par notre intervention, nous serions considérés comme les provocateurs. » (pages 127-128)


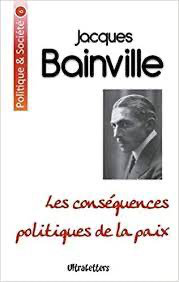


/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)