Les Essais, Michel de Montaigne, 1595 (inachevé), ou Sympathie pour les paisibles
On n’a pas mieux expliqué, je pense, le rapport qu’un amateur de Les Essais entretient avec Montaigne, qu’Orson Welles ne le fit en écrivant ceci, que je tire de la couverture de mon édition :
« Montaigne est le plus parfait écrivain que le monde ait produit. Je le lis littéralement chaque semaine, à la façon dont les gens lisent la Bible, pas très longtemps ; j’ouvre mon Montaigne, lis une page ou deux, au moins une fois par semaine, pour le plaisir, comme ça. Pour moi, il n’y a pas de plus grande joie au monde. En français, pour le plaisir d’être en sa compagnie. Ce n’est pas pour ce qu’il raconte, mais c’est un peu comme d’attendre un ami, vous savez. Pour moi, c’est quelque chose de merveilleux, de très cher. J’ai de l’affection pour Montaigne. C’est un grand ami de ma vie. »
Éloge paradoxal, s’il en est : il ne s’agit pas d’aimer Montaigne « pour ce qu’il raconte » mais pour « sa compagnie ». Étrange compagnie qui ne « partage pas le pain » c’est-à-dire une matière un tant soit peu roborative. Qu’est-ce donc qu’on goûte dans un livre, si ce ne sont les mots ? Et comment juge-t-on un écrivain « parfait » dont on ne lit « qu’une page ou deux », de temps en temps ? C’est absurde. Et c’est pourtant vrai qu’il se lit et s’apprécie ainsi : Welles ne manquait pas, apparemment, de rappeler qu’il s’en faisait un véritable bréviaire…
Lever la contradiction dans la mentalité du lecteur reviendra à indiquer la substance même de l’auteur à travers son livre.
Montaigne est un « grand ami », il est certes foncièrement amical. Indéniablement, c’est un homme sincère et honnête, une nature sympathique, paisible : ce ton de douceur, celui d’un « gentilhomme campagnard du temps de Henri III » (la périphrase est de Voltaire), qui prend longuement la plume pour transcrire ses pensées, avec une franchise directe et cependant une grande modération, séduit sans aucun doute les êtres tranquilles, curieux d’innocente quiétude, désireux des tendres facilités de l’existence, et soucieux de ne pas heurter parce que ne disposant pas des facultés de résistance et d’évolution pour souhaiter pour eux-mêmes les vertus du choc. Tout ce qu’on lit dans Les Essais est déjà su, on n’y apprend rien, et c’est précisément pourquoi Welles ne le lisait pas dans l’ordre : à la suite ou au hasard, c’est la même chose pour ce qui est de s’en édifier, sur aucun sujet on n’y trouve une réflexion singulière. Il ne s’agit pas d’extraire de l’ouvrage des extraits éloquents ou des articles de pensée originale, mais de s’imprégner du ton sans polémique, rassis et qui n’étonne point, de se laisser envahir par l’imperturbable souffle de vérités inutiles et anodines qu’on confond proverbialement avec la profondeur, pour se croire contaminé par une « sagesse », comme si le parangon de la philosophie consistait à ne vouloir que parler sans blesser personne, opportunisme des gens qui estiment qu’être bonhomme, c’est être un homme bon parce que c’est facile. Welles concède qu’il n’apprend rien à lire Montaigne, et il admet que Montaigne le rassure : c’est « l’ami de sa vie » parce que c’est ce dont il a besoin pour se sentir meilleur dans la vie, nécessité d’autant superficielle qu’elle ne s’éprouve que par intervalles (« chaque semaine ») et en général par courtes durées (« pas très longtemps »). On distingue chez Montaigne de la lourdeur fade, et qu’on peut appeler constance, en dépit de sa langue plaisante (plaisante surtout comme étymologique : langue du fondement, rafraîchissante et essentielle), lourdeur qui se signale par l’abus des références, sortes de compilation un peu crâne de tout ce qu’il a lu (la manière instante dont Montaigne semble avoir publié prouverait que, désirant plaire et se diffuser pour exemple, il n'était pas si humblement reclus et solitaire qu’on le peut supposer), et fadeur qui se révèle par ce que, si l’on excepte de la légende ce qu’on croit savoir du fameux « esprit obscurantiste » de la fin du Moyen Âge, ce que dit ici Montaigne est d’une moralité mièvre et indécise, sans caractère ni fermeté, dont le succès se situe dans le contraire des attributs de l’intégrité et de l’idiosyncrasie, à savoir dans une raison que chacun reconnaît et que personne n’ose contredire parce qu’elle se contente d’arborer les insignes du bon-sens le moins controversé – autrement dit, c’est en entier ce que Nietzsche eût appelé de la « moraline », pommade douce et lénifiante, pas contrariante, toujours vraie en ce qu’il s’agit de ne jamais prendre de positions conflictuelles. Montaigne est chrétien, traditionnel, bonasse, et il incite à se fier à la religion de son pays, à ses traditions, à ses valeurs débonnaires ; en somme, et c’est simple à comprendre, c’est un homme qui traverse son temps sans rien égratigner, avec l’air non seulement du temps, mais de tous les temps indécis et évaporés, des temps passés et à venir les plus évidents et incontestables. Il est ainsi l’ami de tous parce que nul ne peut lui en vouloir d’un mot aventuré ou audacieux : il est agréable parce qu’il n’atteint pas, son opinion est celle de quelqu’un qui n’en a pas sinon de s’accorder avec une sorte d’unanimité reculée et paisible. En cela, la lecture de Les Essais paraît inoffensive et universelle : c’est « sage » parce que sans apparence d’erreur, mais puisque c’est surtout sans tentative de se tromper, sans jamais aucun risque, on est aussi bien en peine, comme je l’ai été, d’y annoter un mot profond ou une idée originale et forte, c’est stérile et creux comme un soupir de vieille dame. Le lire revient à asseoir sans apport son goût de la patience ; c’est incidemment s’habituer à ne lire que fadaises émollientes, et, peu à peu, renoncer à l’action sur soi des littératures hardies et bouleversantes, de celles qui, au lieu de conforter, vous forcentet changent. On peut craindre avec l’habitude que chez le lecteur de Montaigne le sens de la philosophie tourne au breuvage tiède sans effets, comme on prend une tisane ou une cuillérée de miel pour remède à la toux ou à la mélancolie : ses péroraisons sont générales, abstraites et irrésolues, et, à bien y regarder, la tenue à tout prix d’un juste-milieu les rend presque toujours contradictoires, les résumant à : « Faire ceci est une faute mais l’inverse est inutile. » Après 150 pages, je suivais toujours des développements qui se résumaient au plaisir de perdre son temps avec un être vieillard, aimable et s’exprimant bien, même trop disert et digressif mais me tenant par l’affection, à la façon dont on s’hypnotise de certaines voix rauques en-dehors même du sujet qu’elles exposent, et… je me suis ébroué – ce qui m’est de moins en moins pénible à force de résolutions fermes et écrites sur la littérature – en songeant que cet exercice méthodique et soigneux ne contribuait en moi à l’ajout d’aucune puissance réelle, d’aucune vitalité mâle, d’aucun apport que peut-être me pourrait faire, quoique improbablement (car je ne me fais pas d’illusion), un autre ouvrage : lire ainsi, c’est une lourde paralysie vers la tombe. J’imagine bien quelle satisfaction on peut tirer de livres comme ceux-ci : par crainte cacochyme de se remuer et scandaliser de pensées fortes, surtout parce qu’on n’a plus la faculté de les suivre et entretenir, on commence à haïr la vivacité et les éclairs, et l’on s’enferme au songe doucereux d’œuvres molles à la Mann, Bernanos, Proust et Pessoa, de ces textes qui convient à atermoyer peu de notions véritablement personnelles en une langueur dont l’ennui passe pour de la grandeur parce qu’on suppose que, puisque les vieux sont capables de regarder durant des heures des voitures passer, assis au perron de leur maison, la patience serait signe de maturité. Et en présence de ces voix où l’individu se résume à une exceptionnelle attente, on se résigne et s’accoutume à appartenir à ces sages longanimes, en immortalité de fossile qui, parce qu’elle requiert un certain effort quoique pas un effort actif, passe indûment, peut-être définitivement, pour de l’humanité, voire pour de l’humanisme, dont on fait un modèle de tempérance supérieure, qui n’est en vérité et par impression qu’une pratique de l’inexistence satisfaite et coite, béate et confite en disparition veule, une minéralisation nonchalante et lasse des fringantes capacités de l’esprit net et vivant.
Post-scriptum : J’ai poursuivi plus loin d’une cinquantaine de pages les cent cinquante annoncés dans cet article. Rien n’y change, non que j’y tienne : ce théorème est exact.
À suivre : Le livre des damnés, Fort


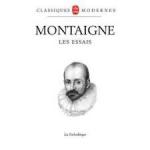


/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)